La grande panne, Hadrien Klent, Le Tripode, 2016
Et si un nuage de graphite, minerais hautement inflammable au contact d’une ligne électrique, nous arrivait d’Italie, comment réagirait le pouvoir politique français ? Il opterait pour la grande panne, tout couper plutôt que subir de petites pannes isolées décidées par le vent. Tel est le point de départ du roman signé Hadrien Klent. Souvenirs croisés de deux nuages, réels, celui de Tchernobyl célébré en 1986 pour son respect des frontières françaises et celui échappé du volcan islandais Eyjafjöll en 2010 qui vida un temps l’espace aérien européen. En 24 ans, la réponse politique a évolué, passant du mensonge d’État au principe de précaution. Ne rien dire ou trop en faire, deux bornes entre lesquelles navigue le pouvoir.
Dans La grande panne, le pouvoir est d’ailleurs tellement prudent qu’il se met lui-même à l’abri, sur l’île de Sein, dotée de ses propres groupes électrogènes. De belles pages, drôles, détaillant les préparatifs de l’installation de tout ce petit monde (présidence et gouvernement) sur ce petit bout du monde. Ou comment l’îlot désolé est transformé en QG tête de pont d’une lutte menée contre un ennemi impalpable. La communication est soigneusement travaillée. La panne sera baptisée coupure (preuve d’une volonté assumée) et l’option mythe fondateur prise (128 pêcheurs sénans ayant rejoint De Gaulle fin juin 1940, ont décerné à leur terre natale un label d’héroïsme et de courage). Le mythe fondateur se doit d’abriter du beau monde.

Dans ce roman drôle, plein d’ironie, de dialogues mordants, deux cercles opposés sont mis en lumière. Le politique, le PR (comme président de la République) et ses quatre conseillers. La figure présidentielle apparaît ici comme un assemblage baroque, un Sarkozy (difficulté à se concentrer, cyclothymie, épuisant son entourage) amateur de Chopin qui aurait fait une thèse sur le sentir-mineur des mineurs au chômage de longue durée et aurait le vague projet d’en écrire une autre, Pour une autosociologie de la présidence : vues, bévues, et m’as-tu vu à l’Elysée. Quelques répliques sur la prise de décision politique résonnent singulièrement dans cet entre-deux tours. Les citoyens savent-ils que leur président ne prend jamais aucune décision ? se demande un des fidèles conseillers. On n’est pas à question pour un champion, hein. Je suis président, je ne suis pas censé tout savoir. Vous êtes là pour ça, non ? s’énerve le PR après un topo tout simple d’un de ses proches sur la distinction entre transport et vente d’électricité. Ou sur le rapport entre un PR omniscient et le peuple qui ne lui cacherait rien : Je reçois des notes blanches, de partout, des préfectures, des RG, des journalistes, il y a même des écrivains qui travaillent pour moi. Et puis les Français m’écrivent, hein ! Ils écrivent ! À leur président ! Ils me parlent ! Je suis dans la tête des gens, au sens propre. Je sais ce qui se passe là-bas, partout, dans toutes leurs petites caboches de Français casse-burnes.
À l’opposé, le cercle des activistes d’extrême-gauche, emmené par Jean-Charles, admiratif de Guy Debord, implacable référent (Il n’est pas vrai que je me brouille avec mes amis, les uns après les autres. Mes amis sont ceux avec qui je ne me brouille pas), plus ou moins liés à des homologues italiens, qui cherchent à tirer parti de la pagaille en remettant à l’honneur quelques grands classiques de la barricade parisienne expérimentés depuis le XVIIIe siècle. En espérant que le peuple jouera le jeu.
Le roman avance par fragments entrelacés. Il passe d’un cercle à l’autre, circule entre les lieux, Paris, Sein, l’Italie, fait quelques allers-retours dans le temps, donne la parole aux personnages, Normand l’écrivain installé à Sein avant la grande panne, ses anciens amis de lycée, Jean-Charles qui ne-lâche-rien, Nathanaël, brocanteur et grand lecteur, devenu le temps de la panne, un informateur incertain au service des États-Unis. Et puis aussi, Jean-René Hunebelle, patron de presse qui retrouve les secrets de l’écriture, la composition, l’impression et la diffusion d’un journal (astucieusement baptisé Le journal, les autres n’existant plus), sans électricité.

Reprenant l’hypothèse du roman éponyme de Théo Varlet (1930), le roman signé Klent imagine une situation de rupture avec notre ère où toute coupure d’électricité devient handicap, empêchement tellement notre dépendance est devenue grande. Progrès et fragilisation. Nous sommes, depuis une trentaine d’années (nous étions, avant cette panne), dans la phase où nous avons oublié le moment où nos ancêtres, d’autres hommes, ont gravi la montagne. Ils ont sué ! Ils ont souffert, eux, de cette absence de facilité à se brancher, n’importe où, n’importe quand. Nous sommes, nous, en plein milieu de la descente, à jouir du confort de l’électricité nucléaire, si facile à produire. Mais la pente n’est pas éternelle. Un jour, il faudra remonter une nouvelle pente. Quand ? Sous quelle forme ? Je n’en sais rien ; je me pose la question ; j’espère beaucoup de la sagacité de mes lecteurs. Dernières lignes de J.-R. Hunebelle dans la der du dernier Journal avant retour à la normale. Lecteurs, pensons.
Il existe un double mouvement dans La grande panne, deux pentes pour reprendre l’image de Hunebelle. La première, vive, sarcastique, nerveuse, documentée, détaille l’orchestration politique et pratique de la panne, l’agitation des activistes, les choix individuels radicaux, fermes (renoncer ou s’engager à fond). La seconde, flottante, fait entendre les voix de l’indécision, du doute, de la nostalgie, du nihilisme. Nathanaël qui a lu tous les livres et qui est triste, écrit dans son cahier Si j’étais un écrivain, ça pourrait peut-être être utile. Des personnages, des humains que je vais transformer en ombres de papier. Mais là je n’en ferai rien, de cette histoire. D’ailleurs je ne fais jamais rien. De rien. S’en suit la transcription des paroles de l’àquoiboniste, signées Gainsbourg.
À la fin, ultime moment de dérision, Normand à Jean-Charles : C’est quoi cette histoire de mine en Italie ? Comme si tout ce qui nous avait été conté ne comptait pas. Dispersion d’un nuage. À moins qu’il ne s’agisse d’une ouverture : et si on racontait l’histoire autrement ? Et si plus tard, je recommençais, autrement, encore, avec d’autres doutes mais aussi un autre désir ?
Sous ce même pseudonyme d’Hadrien Klent, l’auteur a signé Et qu’advienne le chaos (Le Tripode, 2010).

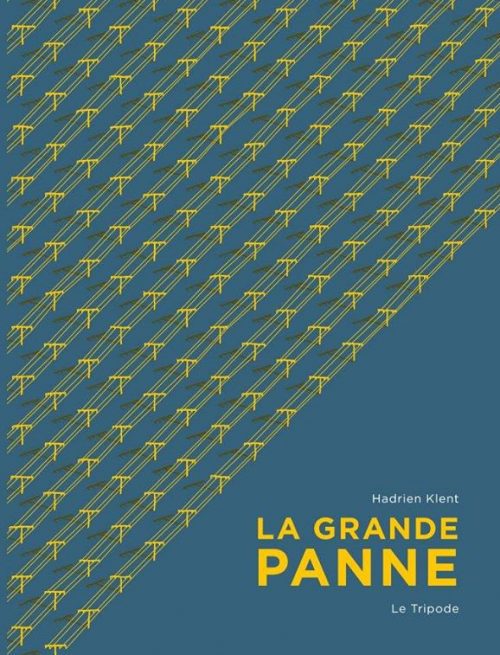
Une réflexion sur « Qui va à Sein en revient »