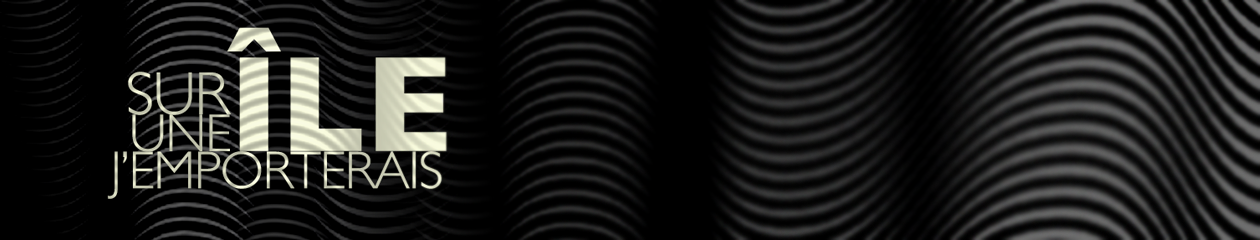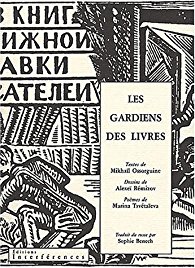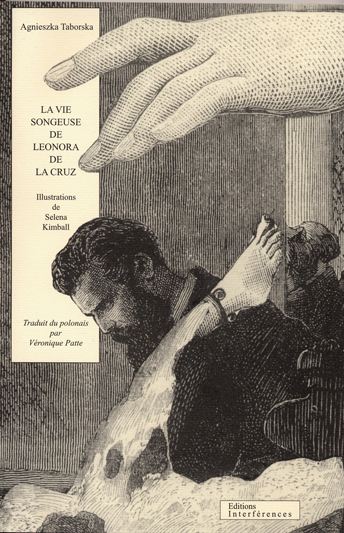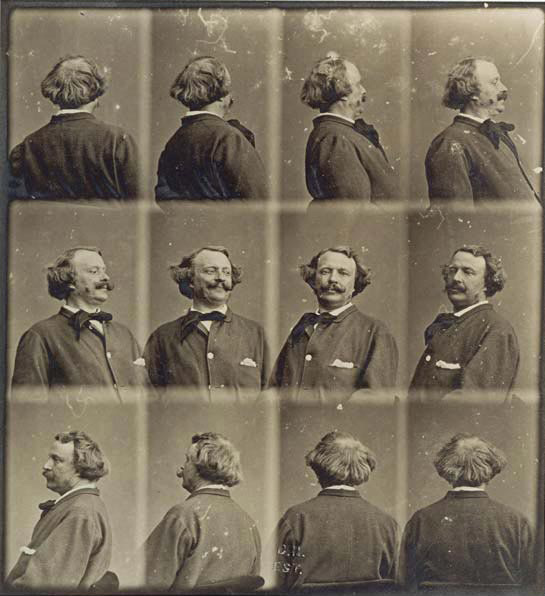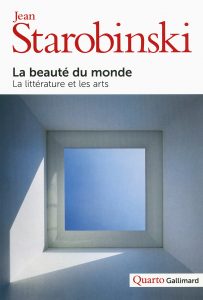Toyen, L’écart absolu, sous la direction d’Annie Lebrun, Anna Pravdová et Annabelle Görgen-Lammers, Paris Musées, 2022

Certains artistes nous font pleinement et sauvagement saisir le sens du mot « Œuvre », celle qui relie leurs créations, au-delà de la diversité (apparente) des techniques et des inspirations. L’exposition que consacre le Musée d’art moderne de la Ville de Paris à Toyen, m’a donné ce choc-là, sentir l’étonnant tout de cette artiste tchèque peu connue, née à Prague en 1902, morte à Paris en 1980. Peinture, dessin, collage, graphisme, les techniques se sont déployées selon les temps et les rencontres. Mais ce qui les traverse toutes c’est la fermeté du geste, l’acte posé, le mystère aussi qui aimante et oblige notre œil à fouiller la surface d’une toile ou d’un papier.
Continuer la lecture de L’étonnant tout de Toyen