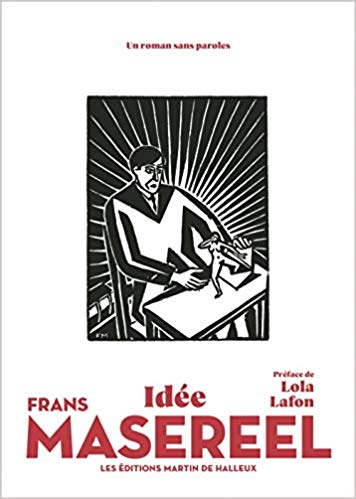Musée, Nicolas Krief, texte de Stéphane Guégan, Gallimard, 2024

Au début, j’ai pensé que c’était un livre-gadget poussé à la lumière de Noël, un livre avec une idée « marrante », une idée « sympa » et puis c’est tout, un livre qui se tiendrait dans un tout petit espace d’invention, fermé sur lui-même, un livre sans fécondité aucune, un livre-concept, je crois qu’on dit comme ça. Et ben non, pas du tout ça. Tu prétends flairer très vite l’essence des livres, en les feuilletant, en grapillant des mots, des images, en y circulant comme tu veux… et tu te trompes. Voilà ce que je me suis dit une fois rentrée chez moi, où assise près du feu, j’ai tourné les pages dans l’ordre, observé chacune des photographies de Nicolas Krief et lu le texte de l’historien et critique d’art Stéphane Guégan.
Musée, c’est le regard d’un photographe sur un moment particulier d’une exposition, celui que nous, le public, ne voyons pas, le temps de l’accrochage. C’est le moment où des métiers se croisent, dialoguent pour déballer, (dé)placer les œuvres choisies, pour créer des cimaises, les peindre, pour fixer les cartels, pour éclairer, faire briller, dépoussiérer. C’est le moment où d’insolites corps à corps ont lieu entre les œuvres et les humains. Et nous, le public, on entrera, une fois cette cuisine de formes et de sens achevée, et nous ne saurons rien du ballet qui a couru dans les salles et sur les murs. Tout aura été fait pour le faire oublier.
Musée aurait pu s’intituler Accrochages, titre du texte de présentation de Nicolas Krief. Cela aurait été plus juste. Ou Mur du songe, titre de celui de Stéphane Guégan. Cela aurait été plus poétique. À moins qu’on entende le musée comme un lieu plus vaste que celui qu’on connaît, qui le dépasse, un espace-temps qui ferait chanter les œuvres dès les premiers préparatifs de l’exposition, à coups de télescopages et de malicieux écarts.
Nicolas Krief travaille avec l’instant. Il affirme : « Pas de mise en scène, pas d’éclairage d’appoint, pas de matériel de pose. » Et pourtant, on l’imagine tellement cette mise en scène… Qui a guidé ces mains gantées de caoutchouc sur les cuisses de ce faune de pierre ? Qui a suggéré à cet homme en jean et chemise marine de se poster ainsi face à l’homme peint par Caillebote ? Qui a chorégraphié la scène où trois installateurs à genoux cernent un corps torturé signé Henri Pontier ? Qui a suggéré à cet homme à la peau noire de regarder ainsi ce taureau blanc, œuvre de François Pompon ? Certaines images ont l’air de sortir d’un film de Bill Viola, ce vidéaste dont les performances frappent par leur mise en scène poussée à l’extrême. Mais non, juste l’instant, le kaïros du photographe.

Nicolas Krief explore l’œuvre comme objet d’attentions. « J’ai d’abord été saisi par la technicité et la précision des gestes, qui donnaient une théâtralité aux scènes auxquelles j’assistais. […] j’ai très vite eu le sentiment qu’une authentique religiosité animait ces moments tenus secrets, à l’abri du regard du profane, où clercs et servants officiaient pour la préparation du culte. »
Et les photographies se chargent elles-mêmes de quelque chose de sacré, d’énigmatique, de burlesque aussi. Je pense à des collages de Max Ernst, à des films de Jacques Tati. Dans la zoothèque du Muséum d’Histoire naturelle, un homme a pour tête celle du bouquetin taxidermisé qu’il porte. Celle d’un autre homme est cachée par le tableau qu’il a dans les mains. L’oeuvre lui fait littéralement perdre la tête. Une femme avec aspirateur en hotte dans le dos, nettoie une vitrine de robots-jouets comme inspirée par l’objet de son aspiration.
Les jeux entre scènes réelles et scènes figurées se démultiplient, comme si les oeuvres ne pouvaient qu’inviter à de nouvelles lectures, naïves ou métaphysiques, drôles ou profondes. La frontière entre réel et art s’estompe par le jeu de la photographie qui les réunit et les articule. Par la grâce de ce regard et de ce beau livre pas-gadget-du-tout, l’institution musée qui agace parfois (trop de raideur, trop d’hermétisme, trop de convention, trop de démagogie…), se raconte ici, avec une poésie pleine de fraîcheur. Tant de mains, d’yeux, de corps humains s’activent auprès des corps peints, sculptés !

Un ballet qu’on peut voir comme la métaphore d’une relation renouvelée, réveillée, entre public et œuvres. Un public qui oserait se débarrasser d’un rapport conventionnel avec l’art, pour s’aventurer dans un face à face, un corps à corps sensible, audacieux, libre.
Depuis 2010, Nicolas Krief développe des projets photographiques liés à la préparation d’expositions organisées par de grandes institutions (Grand Palais, Musée d’Orsay, Louvre, Musée de l’Homme, Muséum d’Histoire naturelle…). Les photographies de Musée sont tirées de ces « avant » d’exposition.
Spécialiste du XIXe et du XXe siècle, conseiller scientifique auprès du Musée d’Orsay, Stéphane Guégan est notamment l’auteur de Baudelaire, l’art contre l’ennui (Flammarion, 2021), Caillebotte, peintre des extrêmes (Hazan, 2021) et Bonnard (Hazan, 2023).