Je connais depuis peu les éditions Interférences. Hasard d’une découverte en librairie, l’album illustré, La vie songeuse de Leonora de la Cruz, puis lecture du texte de Varlam Chalamov, Mes bibliothèques. J’ai cherché ce qui reliait les ouvrages de cet éditeur, si beaux. Toute l’image de couverture, gravure au noir, enveloppe le bloc des cahiers intérieurs et un immuable cartouche vertical regroupe auteur, titre et traducteur. Les auteurs sont souvent russes, mais pas toujours, souvent morts, mais pas toujours. Un couple, père et fille, Alain et Sophie Benech, est à l’origine de la maison. J’ai rencontré la fille, traductrice, amoureuse du russe, de la Russie et de la littérature. Portrait d’une éditrice qui défriche à pas comptés (2 titres par an) mais dont le catalogue, déployé sur une table, fait merveille.
À 17 ans, Sophie se demandait comment une vie ne pouvait être radicalement changée par la lecture des Frères Karamazov. À 23 ans, après des études littéraires, elle part au pays de Dostoïevski, y apprend la langue, en travaillant, en écoutant. À Paris, rue Linné, Alain possède la librairie Interférences. Du couple naît en 1992, le petit Chalamov cité plus haut, extrait des Récits de la Kolyma. C’est un acte isolé, pas encore question de créer une maison d’édition. Deux ans plus tard, un deuxième paraît, Les gardiens des livres. Encore l’amour des livres et de la Russie. Et puis, poussés par un distributeur avec lequel ils contractent, ils installent une régularité annuelle de publication.
Quand je demande à Sophie quelle île pourrait être sa maison d’édition, elle pense au pluriel, un archipel, volcanique, fait d’une même matière, relié par quelque chose de souterrain, de sous-marin. Elle pense à celui, russe bien sûr, des Solovki. Sur la mer Blanche, frôlant le cercle polaire, ces îles ont successivement été lieu religieux (depuis le XVe siècle, un monastère forteresse aux multiples bulbes occupe l’île principale) puis à partir de 1920, premier camp d’internement décidé par Lénine, préfigurant l’archipel du goulag. Écrivains et grands intellectuels y furent enfermés. Lieu de livres aussi. Élisabeth Kapnist et Olivier Rolin en ont raconté l’histoire dans Solovki, la bibliothèque disparue. Récemment, les îles ont été rendues aux moines. Dotées d’un micro-climat, elles abritent des espèces végétales et animales uniques et sont un parc naturel protégé. Comme les îles Solovki, les éditions Interférences sont à part et profondément liées à l’histoire russe, en disent des couches, des intensités chaotiques. Plusieurs de leurs auteurs (Chalamov, Rossi) ont été internés dans les camps, d’autres (Zamiatine, Khodassévitch) ont fui la pression soviétique, Pilniak y été fusillé.Mais pourquoi la Russie ? On a dit Dostoïevski, mais tous ses amoureux ne deviennent pas traducteurs, éditeurs ou même à ce point russophiles. Il me semble que quand les gens sont attirés par un autre pays c’est parce que quelque chose, en eux, ne peut s’exprimer dans leur propre culture. Sophie hésite, peine à préciser pour elle. Beaucoup de choses me sont plus proches chez les Russes que chez les Français. Tous mes amis sont russes ou ont vécu en Russie. Sophie parle d’une autre perception du monde, une autre échelle des valeurs, une autre façon de prendre la vie. Quand je suis allée au début en URSS, j’avais l’impression que tout ce qui est important, la liberté, la dignité, la vie, la faim, la mort, était moins enrobé qu’ici. Là-bas, il y a quelque chose de plus à nu. Le pays la relie à une conscience de l’essentiel. J’avais un ami Jacques Rossi qui avait passé 17 ans au goulag et qui disait toujours « Ici, vous êtes des enfants. »
Sophie préfère que ça résiste. Dans tous les sens. En URSS, des gens avaient conscience de ce qui se passait, ça veut dire qu’il y a quelque chose qui peut pousser même dans les pires endroits, comme les petites herbes qui sortent du macadam. Sophie aimait aller voir ce qu’il y avait derrière la palissade sale, grise, moche du communisme, soulever une latte. Ce qu’on peut découvrir soi-même est plus intéressant que ce qui est donné.
Il y a le même souci de l’essentiel dans les liens que la traductrice entretient avec ses auteurs adorés (Isaac Babel, dont elle a traduit l’œuvre intégrale au Bruit du temps ou Anna Akhmatova dont elle est en train de traduire des souvenirs chez le même éditeur). Un écrivain met l’essentiel de lui-même dans ses livres. Le traduisant, vous êtes dans un corps à corps avec ce qu’il a de plus profond.
Comment choisit-elle les titres à publier ? Pas d’autre règle que celle du plaisir, le sien, celui de son père. Ils ont des goûts communs, même si un livre peut enthousiasmer plus l’un que l’autre. Sophie édite ce que lectrice elle aimerait acheter. Un livre en entraîne un autre, un fil parfois invisible, les relie. Un auteur en appelle un autre. Jacques Rossi, ancien communiste franco-polonais (Qu’elle était belle cette utopie !) vient en contrepoint des récits de Chalamov, partageant une peine pensante avec Vassili Grossman (La Madone Sixtine, réflexion sur ce qui reste d’humain après les massacres de la Deuxième Guerre mondiale).Le catalogue s’est déployé hors de Russie. Premières ou nouvelles traductions issues du monde anglo-saxon (Ambrose Bierce, Louisa May Alscott, Rudyard Kipling, Virginia Woolf) que Sophie regrette de n’avoir le temps d’explorer plus et quelques titres français signés Victor Hugo (L’aquarium de la nuit, assemblage de fragments épars, invitation à pénétrer l’immensité de l’œuvre) ou Guy de Maupassant (Sur Flaubert). Ces derniers textes découverts en passant par la Russie… c’est en préfaçant sa traduction des œuvres d’Isaac Babel qu’elle en a trouvé la trace.
Pourquoi ce métier d’éditeur ? L’espoir que dans vingt ans, ses livres seront toujours là. Espoir qu’ils sèment des graines, pour faire pousser quelque chose d’authentique, d’essentiel, aider à vivre par des moyens pas du tout visibles. Plaisirs simples et profonds, faire et partager les livres qu’elle aime. En librairie, elle présente sa maison, adore lire à voix haute, connait presque par cœur ceux qu’elle a traduits. Je sais choisir les extraits et quand je lis, tout le monde a envie d’acheter ! s’amuse-t-elle. Le best-seller de la maison est le Chalamov, retiré cinq ou six fois. L’ouvrage de V. Woolf (Au hasard des rues) et même les poèmes d’Anna Akhmatova se vendent bien. Une femme rencontrée récemment au marché de la poésie, revue deux jours plus tard, lui a confié que les recueils de la poétesse trônaient désormais sur sa table de nuit. Ce genre de goutte d’eau qu’aime Sophie Benech. Pas la quantité qui compte, juste le mouvement, donner envie à un autre, transmettre un peu de ce qui nous a ému, changé. Des graines d’essentiel.
Chez d’autres éditeurs, outre l’œuvre intégrale d’Isaac Babel (Le bruit du temps), Sophie Benech a traduit Leonid Andreïev (intégralité de sa prose narrative, José Corti), Iouri Bouïda (Voleur, espion et assassin, Gallimard, 2018), Varlam Chalamov (deux des six livres des Récits de la Kolyma, Verdier, 2003), Svetlana Alexievitch (Ensorcelés par la mort, Plon, 1995 et La fin de l’homme rouge, Actes Sud, 2013), Ludmila Oulitskaia (quasi-totalité de l’œuvre, Gallimard), la correspondance entre Boris Pasternak et Varlam Chalamov (Gallimard, 1991).


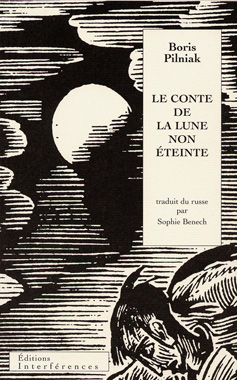
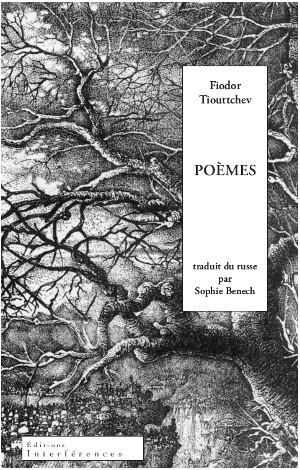
2 réflexions sur « Sophie Benech, entre ici et Russie »