Au cirque, Patrick Da Silva, Le Tripode, 2017
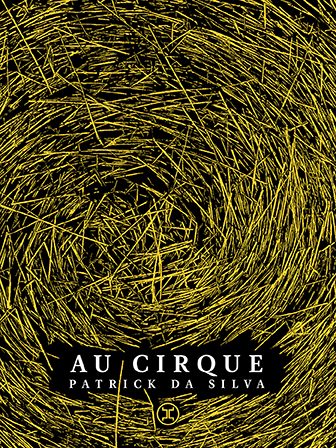
C’est une histoire. Elle est écrite depuis les temps immémoriaux ; elle s’écrit à nouveau ; celle-là même, entre quelques autres. On la connait. Elle ne cesse de s’écrire avec les inflexions, des variantes mais la même. (…) histoire de dire les abîmes qui nous traversent, nous aspirent, que l’on fuit, qui nous fondent, cette violence animale et céleste, qui nous anime, nous agit et nous brûle. Extrait de la postface d’Au Cirque de Patrick Da Silva. J’ai envie de commencer par ces mots de la fin qui disent sans détour l’éternel de l’histoire, l’éternel de ce qui recommence à s’écrire parce que ça a toujours été là et continuera de l’être. Au cirque raconte par la fin une tragédie familiale, mère retrouvée pendue, yeux du père arrachés, langue et sexe tranchés. Et puis, on remonte le fleuve dangereux de l’histoire, convoqués par l’irrésistible envie de savoir. Pourquoi ? Comment ça a commencé ? Qui a fait le coup ?
P. Da Silva emprunte à la tragédie grecque, à Sophocle. C’est l’histoire de Jocaste, mère et femme d’Œdipe qui revient, transposée. Observateur méthodique, le narrateur donne le tempo, incitant régulièrement, à remonter aux sources de la noire destinée (Allons ! Nous poserons ce que nous savons. C’est par là que nous commencerons ! Qu’est-ce que nous en déduisons ?). À l’orée de chaque chapitre, nous sommes invités à regarder (Voyez !), écouter (Prêtons l’oreille, encore et toujours soyons attentifs). Raison et sens sont mobilisés pour vivre l’histoire, défi cathartique du théâtre.
La famille compte quatre enfants, deux filles (la cadette, la dernière) et deux garçons (l’aîné, le second fils). Ils ont passé la trentaine quand le drame survient. Chacun prend la parole, donne sa version, sauf la dernière, un peu simplette. Les parents se sont tus et les enfants parlent, tissent la narration. Quatre voix entrelacées mises à jour après la mise hors-jeu des parents.
La mère revient, souvenir des enfants ou personnage des pièces de théâtre qu’ils aiment, depuis l’enfance, jouer ensemble. Certains enfants se glissent dans la peau d’un autre membre de la famille, inventant un théâtre dans le théâtre. C’est une tradition dans la famille. Dans la bibliothèque ils jouaient leurs mystères, le drame, la farce. Ce qu’ils représentaient dans leurs mystères, c’était la vie, les scènes de leur vie, ce qui s’était passé, la vérité. Pour jouer la vérité, ils distribuaient, ils échangeaient les rôles. La vérité, comme une chose qui ne peut sortir d’une seule bouche, pas directement, en permanence confrontée à d’autres paroles, jamais donnée vraiment, toujours cherchée, essayée par la représentation. P. Da Silva fait tourner les rôles, les interprétations possibles. Qui a tué la mère ? Qui a mutilé le père ? Qui sait quoi ? Que sait-on finalement ?
La langue de P. Da Silva est mêlée. Les expressions populaires, imagées, anciennes, remontent à la surface, croisant le précieux des subjonctifs (nous sommes dans une maison de maître, petit manoir d’une noblesse terrienne et ruinée). La mère (jouée par le second fils) : J’entends correctement là ? Mes esgourdes en font des leurs ! Me leurreraient-elles mes esgourdes ? Merci ! Vous m’avez dit merci ? A moi votre mère ? Votre mère à qui, quoique grâce à Dieu elles lui fissent défaut, vous brisez menu, depuis un mois, jour après jour, les roubignoles ? Eh bien mon garçon, vous me la baillez belle ! La langue de la mère porte la trace de ce passé qui ne peut disparaître et que plusieurs enfants cherchent à éclaircir. Au cirque est une enquête, l’enquête d’une vie. Qui est le père ? Qui est la mère ? Qui est-on ? Depuis Œdipe-roi de Sophocle, les questions de l’identité, la culpabilité, la faute, l’innocence restent intactes, régulièrement travaillées par de nouvelles œuvres.
Le texte de P. Da Silva reprend le mythe d’Œdipe tout en en représentant, par son obsédante musicalité, l’irrésistible attraction, ce qui fait qu’il revient, tourbillon aspirant et inspirant. On sait, on est de la famille. On sait qu’à la fin, l’énigme se résout, le secret s’élucide. Rien pour autant ne s’épuise et l’effroi reste entier, lit-on encore dans la postface. Singularité de la grande famille humaine qui pour mieux se vivre, a besoin de se représenter encore et encore. J’ai entendu le texte à la lecture. Je rêve de son adaptation sur une scène. Sa force, son épaisseur, sa poésie et sa vitalité y rayonneraient.
Né en 1956 à Clermont-Ferrand, Patrick Da Silva a écrit dans plusieurs genres : nouvelles (Jeanne, Editions du Chemin de fer, 2014), théâtre (En revanche, Editions Espace 34, 2004), roman (Apostat, 2003 et Depuis, 2001, tous deux publiés par Fayard) et poésie (Métairie des broussailles, Cheyne éditeur, 2000).


3 réflexions sur « On sait, on est de la famille »