Le détour, Luce d’Eramo, traduit de l’italien par Corinne Lucas Fiorato, Le Tripode, 2020
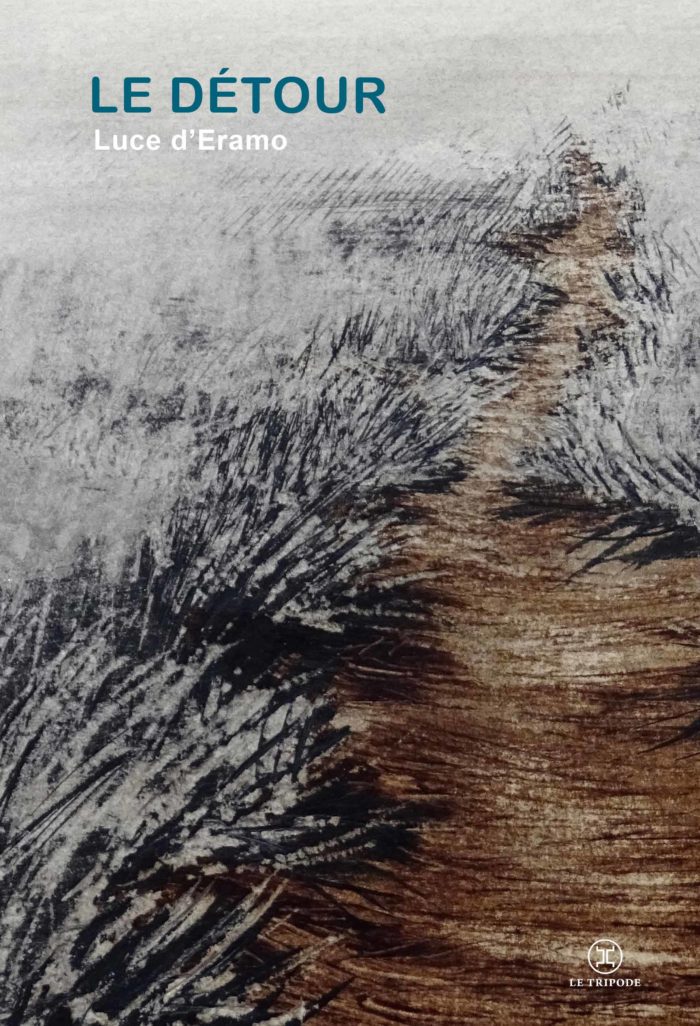
Commencé avant le confinement, terminé pendant. Livre à la frontière, dedans, dehors. Livre qui laisse une marque, incertaine, confuse, forte. J’ai entendu une voix, celle d’une femme, décidée à se souvenir, qui s’y reprend pour raconter, faire remonter le passé, pas seulement pour en rendre compte, mais aussi pour y croire elle-même, édifier quelque chose d’elle-même en le travaillant avec son présent et par l’écriture. Italienne, née à Reims, Luce d’Eramo a 13 ans quand elle quitte la France, en 1938, pour rentrer avec ses parents en Italie. Famille fasciste (le père devient sous-secrétaire d’État de la république de Salò en 1943). Elle en a 19 quand elle décide d’aller voir par elle-même ce qui se passe dans les camps nazis. On raconte tant d’histoires. Elle part, portraits de Mussolini et d’Hitler dans son petit bagage, s’engage comme ouvrière volontaire en Allemagne. Le détour est la somme agitée et vivante de ces remémorations.
En février 1944, Luce s’engage comme ouvrière dans le camp de l’usine d’IG Farben à Höchst, près de Francfort. En décembre 1945, elle revient, paralysée (l’écroulement d’un mur lui a fait perdre l’usage de ses jambes) en Italie. J’ai essayé d’établir la chronologie des actions, travail dans un Lager, un autre, évasion, rapatriements. Je n’y suis que partiellement arrivée. La lire c’est lâcher l’Histoire, les idéologies, ou non, c’est entrer dans leur chair, pénétrer une matière humaine, faite de situations, d’actes, de rencontres brutes avec des compagnons d’usine ou de châlit. C’est suivre le parcours d’une femme, si vive, si réactive, si en permanence dans le moment, la situation, l’énergie de ce qui se déroule, dans son envie de savoir par la vie-même, que les Lager, la faim, l’hostilité, la violence, la douleur ne semblent pouvoir l’entamer.
Le détour est fait de récits successifs datés de 1953, 1954, 1961, 1975 et 1977. Dans le récit de 1975, elle dit les rapports difficiles avec les Français et les Italiens, dans le camp d’IG Farben. Elle est fasciste après tout. Et la jeune femme de se faire sa propre place, de frondeuse. Elle réclame de meilleures conditions de travail, brandit devant le directeur du camp l’égalité des peuples, seul fondement possible d’un Reich millénaire. Le récit de 1953 évoque un séjour postérieur, à Dachau. J’appartenais à l’équipe chargée de nettoyer les égouts de la ville de Münich. (…) Mais le pire c’était quand on nous emmenait dans les villages nettoyer les fosses d’aisances. (…) Beaucoup de gens tombaient malades et certains mourraient intoxiqués (…). Mais il y avait aussi les bons jours, quand les déchets ne bouchaient pas les tuyaux, les toilettes publiques fonctionnaient normalement et le « grand canal » coulait sans s’engorger : on nous élevait alors au rang de Mistbreiter, épandeurs de fumier. Plus loin, on lui dit : « Tu peux t’estimer heureuse qu’ils ne t’aient pas encore expédiée dans un de leurs bordels. Une fille de dix-neuf ans, qu’est-ce que tu espères… la liberté dans le Troisième Reich ? » On voit la fille cultivée née dans la bourgeoisie, s’ébrouer dans la noirceur, traquer quelque chose qu’elle ignore mais que la succession des récits met à jour.
Chacun d’eux est extraction, prélèvement d’une expérience que l’écriture restitue, forme. Pas d’illusion sur le rapport au passé (A force de répéter que j’avais été déportée à Dachau, j’ai fini par y croire). Elle façonne, avance, recule. A coup de lettres retrouvées aussi. Sa mère, l’immobilité parfaite, en 1944 : Il me semblait inutile que tu t’exposes pareillement afin de rétablir des vérités indiscutables. Et une des origines du titre : Espérons au moins que cette aventure t’aura appris que chacun doit vivre sans détour son chemin. Comme disait Manzoni, « des choses de la vie n’expérimente que ce qui te sert à t’en désintéresser ».
Souvent, je pense à ce qui me reste des livres lus. Un passage, une sensation d’ensemble, un personnage, une idée, une phrase. Et je me demande de quoi est fait tel ou tel, comme si on pouvait en presser une essence, en dire la matière. Est-il de bois, sculpté, fait d’une porcelaine maniérée, chichiteuse, d’un métal brut ou poli ? Le détour est aqueux, sauvage, un torrent, l’écume, le mouvement, il ne s’installe pas, ne pose pas, ne trône pas, il fourrage, creuse, crayonne, trace, se moque des regards, des juges, préoccupé de son seul trajet. Le détour est parcours, détours. Ceux de Luce bien sûr, mais aussi ceux qu’elle nous oblige à opérer. L’essayiste Daniella Ambrosino dit d’elle qu’elle a toujours défié la sédentarité des lecteurs. L’écriture, et la lecture, trajets aux points d’arrivée incertains, dont on doute encore à la fin (ou ce qu’on nomme ainsi, un livre publié ou refermé). Par son écriture rageuse, fouineuse, Luce d’Eramo m’a mise dans cet état-là, une excitation vitale et un sentiment d’inaccompli aussi, tellement ce qu’elle pose est souvent remis en cause plus loin, recouvert, détourné, annulé par une autre perception.
Au hasard, pour illustrer. Au cours de mes douze semaines à Dachau, je n’ai cessé un instant de m’étonner devant l’infinie quantité de désagréments que l’organisme humain est capable de supporter. J’en arrivais à rire en repensant que j’avais été scandalisée par la façon dont les étrangers de Höchst étaient traités (…). Ici on respirait l’intolérable, l’indignation tendait à fondre en une sorte d’hébétement. En vérité, je me suis échauffée au début. (…) Par la suite, j’ai compris qu’il n’y avait pas de quoi s’abattre si dans ces corps affaiblis s’éteignait également l’esprit. (…) En quelques semaines, je me suis plongée dans une seconde découverte qui a chamboulé tous mes repères précédents. Je veux parler de la normalité absolue du crime, de la violence physique, de la délation, la perversion qui nous paraissent tout de suite naturels, familiers, comme une routine.
Comme pour cette chronique, dont je cherche une fin, mais dont je comprends qu’elle n’existe pas, le questionnement et la vitalité soufflés par la narratrice sont plus précieux.
Luce d’Eramo (1925-2001) a étudié la philosophie, soutenu une thèse sur Kant, elle est l’auteure d’une oeuvre abondante (romans, contes, essais). Publié en Italie en 1979, Le détour paraît la même année chez Denoël. Le texte édité par le Tripode est une nouvelle traduction, enrichie d’un entretien avec Corinne Lucas Fiorato, professeure émérite à l’université de La Sorbonne Nouvelle – Paris 3.

Luce d’Eramo aurait infiniment apprécié votre commentaire.
Corinne Lucas Fiorato
(traductrice du roman)