Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, Alice Munro, traduit de l’anglais (Canada) par Agnès Desarthe, L’Olivier, 2019
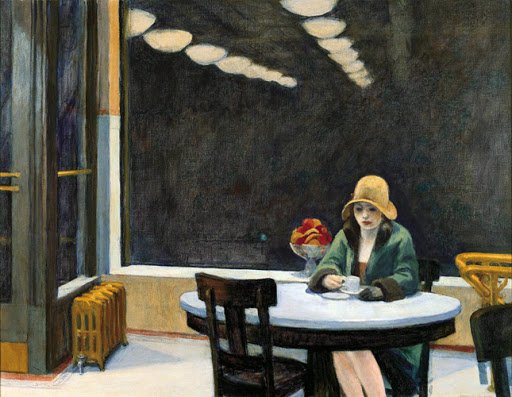
C’est le deuxième recueil de nouvelles d’Alice Munro que je lis, chronique. Je ne sais pas si c’est la littérature que je préfère. Mais la formulation, trop ramassée, a-t-elle un sens ? Mon attrait pour les textes ressemble à une nuée d’étourneaux immense et mouvante, prenant un cap, en changeant pour un autre, se déformant, restant nuée. Qu’est-ce qui fait goût, laisse une empreinte ? Lisant, je chemine avec cette question par en dessous. Et les éclats à la lecture sont des réponses, micas donnant au sable fin ses parcelles d’or. Alors, comment elles brillent les nouvelles de Munro ?
Pas toutes de la même façon. C’est le truc avec les nouvelles. Morceaux séparés mais unis. On pénètre successivement dans les maisons d’un même village, attenantes, mais différentes. On nage dans les courants d’une même eau, mais qui n’auraient pas tout à fait la même température, la même odeur, sel ou vase, des algues nous surprennent et puis plus rien, juste le lisse de l’eau.
Dans Le mobilier familial, la narratrice fait le portrait de sa tante Alfrida, rédactrice d’un magazine féminin, grande prêtresse de la page Flora Simpson à votre écoute. Répondant aux interrogations des lectrices (liste de mariage, beauté, santé, maison), elle privilégie la surface du corps, du couple, de la vie sociale. Peignant celle qui ménage chèvre, chou, virevoltant sur le grand plateau du sens commun, Alice Munro dessine sans s’étendre, un envers, un enfoui d’Alfrida. Et on la suit, enfant à qui on dévoile l’histoire d’une tante avec ses dents intéressantes, chacune d’une teinte subtilement différente de celle des autres, ses sarcasmes et ses secrets. Double de Munro, la narratrice, dit aussi un parcours, par touches, vers l’écriture, avec cette tante au beau milieu, écœurante, contre-modèle pathétique et attirant.
Je ne peux pas dire que les mots de Munro, en eux-mêmes, me touchent, j’ai du mal à trouver des endroits qui me charment, que j’aimerais citer. La force de sa langue vient plutôt de ce qui s’évapore d’elle, flotte à la lecture, ça enveloppe, prend place dans une réalité très façonnée mais non close. Le pouvoir d’évocation, qui séduit ma nuée d’étourneaux. J’ai connu Alfrida comme j’ai connu Nina, dans une autre nouvelle, Le réconfort. Le mari de Nina, Lewis, professeur de sciences a donné sa démission du lycée, écœuré, cible de critiques créationnistes. Lewis est aussi atteint d’une sorte de sclérose en plaque. Il se suicide, acte réfléchi et discuté avec Nina, mais le fait sans la prévenir précisément du moment et la voilà qui retourne toute la maison pour retrouver la lettre d’adieu. L’histoire se poursuit avec le croque-mort, Ed, un ami de Nina, qui a retrouvé le billet dans la poche du pyjama que Nina n’a pas eu l’idée de fouiller. Et le billet continue son chemin, que je ne raconte pas.
Munro construit ses histoires, assez longues, 40 à 50 pages, avec des allers-retours dans le temps, les souvenirs remontent, ce n’est pas linéaire, elle nous plonge là puis là, fait des détours, l’image de la nuée d’étourneaux ne m’est pas venue par hasard. Ses textes flottent, s’étirant vers là, puis se contractent en un point, un objet. Dans la première nouvelle qui donne son titre au recueil, tout un mobilier quitte une maison pour une autre par le fait d’une machination épistolaire fomentée par deux jeunes filles, qui veulent se moquer de Johanna, signant pour elle des lettres d’amour naissant et conduisant celle-ci à voler des meubles sans le savoir et aller vivre, sur un malentendu, avec un homme. Dans Le mobilier familial, une lampe est considérée comme responsable de la mort de la mère d’Alfrida et dans la brocante au rez-de-chaussée de l’immeuble d’Alfrida, la narratrice découvre un seau à miel du même modèle exactement, avec un ciel bleu et une ruche dessinée dessus, que celui dont je me servais pour apporter mon repas à l’école, quand j’avais six ou sept ans. Je me rappelai avoir vu des centaines de fois les mots inscrits sur le côté. « Seul le vrai miel cristallise ». Comme les objets, points de fixation, qui concentrent, sens et bouts d’histoires.
Le texte de quatrième de couverture du recueil conclut « neuf histoires d’amour, en somme ». Certes, mais les mailles de la formule sont un peu lâches pour attraper le mot. J’aurais plutôt dit, avec un sens du commerce qui peut déconcerter, « neuf histoires de mort ». La mort est dans chaque nouvelle, clé de voute d’une vie, mise en lumière (après la maladie, l’accident, le suicide) ou pâleur toujours là. Dans Le réconfort, Nina demande à Ed le thanatopracteur de lui décrire son travail, elle veut savoir comment il a préparé son mari. Et il y va : En gros, ce qu’on commence à faire, c’est drainer le sang des vaisseaux et l’ensemble du corps, et il arrive parfois, lors de cette opération, qu’on rencontre des problèmes, comme des caillots, par exemple, et donc il faut trouver des solutions. La plupart du temps, on passe par la jugulaire (…) Ensuite, on injecte un fluide, une solution de formaldéhyde, de phénol et d’alcool, à laquelle on ajoute parfois un colorant pour les mains et le visage. Nina est reconnaissante à Ed de sa précision, lui-même assez heureux de pouvoir parler de son métier sans percevoir le dégoût ou la peur.
J’ai bien aimé ça, ces façons de considérer la mort avec simplicité, sans charrier forcément l’attirail du drame et de la glue compassionnelle, sans cynisme non plus. Un point d’équilibre, une quasi doctrine de la narration, construite par une langue concrète, précise, on pourrait dire hyperréaliste, mais avec ses trous, ses puits, au fond desquels on a envie d’aller voir.
Née en 1931 au Canada, Alice Munro a écrit essentiellement des nouvelles (une douzaine de recueils parus parmi lesquels Fugitives, L’Olivier, 2008 ou La danse des ombres heureuses, Rivages, 2002) et reçu le prix nobel de littérature en 2013.
